Vivre ensemble – être solidaire – partager ce qu’on sait faire/sait être
Une bonne centaine de participantes et participants venus de toute la Suisse ont répondu à l’invitation de la conférence « Diaconie Suisse » et se sont retrouvés le 29 novembre dernier à la Maison du peuple de Bienne pour parler de « communautés bienveillantes ». C’est l’expression que les Québécois utilisent pour rendre l’idée de « Caring Communities », les communautés qui prennent soin d’autrui ! Quelle est la place et le rôle des Églises et de la diaconie au sein de ces communautés ? Qu’est-ce que ce soin (« care ») ? Est-ce là simplement un nouveau vocable pour une réalité bien connue ? Prenons-nous assez soin du soin ? Chacune, chacun trouvera sa réponse.
La journée organisée par « Diaconie Suisse » s’est articulée en trois chapitres :
- écouter les apports théoriques de trois experte et experts, en plénum,
- participer aux moments d’échange d’expérience en petits groupes,
- lier la gerbe, lors d’un temps final en plénum, un temps de parole libérée par les dessins humoristiques croqués par le pasteur Georg Schubert au cours de la journée et la conclusion des organisateurs.
« Une expérience de compassion, comme celle du bon Samaritain, bouleverse les savoirs et, surtout, dérange (Lytta Basset)
Matériel
Une affaire d’entrailles
L’Évangile ne recourt pas à un substantif pour dire la compassion, mais à un verbe, sous forme passive qui plus est : être pris aux entrailles. C’est une expérience que vit d’abord Jésus, mais qu’il pense accessible aux êtres humains. L’Évangile ne le dit pas mais le sous-entend : c’est la présence de Dieu qui prend l’être humain dans l’intime de son corps. Il y a toujours une distance géographique ou physique, à forte portée symbolique, entre protagonistes, là où la compassion peut émerger et nous rapprocher de l’autre. Cette distance nous permet justement de percevoir ce que l’on ne percevait pas avant, de porter un autre regard sur la vulnérabilité, sur la souffrance d’autrui. Cette distance est essentielle, la compassion n’est pas fusion, on ne se projette pas sur l’autre, on se laisse saisir.
Lytta Basset a le don de dégager les archétypes des récits bibliques et de nous les rendre proches. Alors qu’elle décortique la parabole du bon Samaritain (Luc 10,25-37), on est tantôt légiste (celui qui, dans l’ordre du mental, se demande qui est son prochain), tantôt prêtre (qui passe à bonne distance), tantôt lévite (celui qui est dans le registre du savoir et passe également son chemin pour éviter d’être contaminé par le sang, impur) et tantôt Samaritain, celui qui se laisse émouvoir. À l’époque du Christ, les Samaritains savent ce que c’est que la discrimination et le rejet. Le bon Samaritain a, lui aussi, fait l’expérience de la souffrance. Il est capable de franchir, sans parole, la distance entre son corps à lui, pris aux entrailles, et celui de l’homme que les bandits ont laissé à moitié mort sur le bord de la route.
Un souffle qui nous déplace
Une expérience de compassion, comme celle du bon Samaritain, bouleverse les savoirs et, surtout, dérange : il se détournera alors de sa route (de son objectif, de son emploi du temps, de son souci d’efficacité) pour s’occuper du blessé. La compassion le projette hors du temps, elle s’avère très agissante, sans activisme (le grand piège de la vie communautaire, selon Lytta Basset) toutefois. D’autres paraboles nous permettent d’identifier les peurs qui nous ferment à la compassion :
- la peur de la proximité et de l’engloutissement par le problème, la souffrance d’autrui, la peur d’être manipulé, de perdre pied, poussé par une déferlante compassionnelle. Dans la parabole du fils prodige (Luc 15,11-33), Jésus insiste sur la distance, une distance – celle qui permet au père de voir son fils avec d’autres yeux – qui rend possible de se différencier, d’aller au bout de soi-même pour ne plus ressentir le besoin de se protéger de la souffrance ;
- la peur de l’inconnu: où va nous mener la compassion ? Ne va-t-elle pas nous déstabiliser, nous entraîner malgré nous là où nous n’avions pas prévu d’aller ? Au début de l’Évangile de Marc (1,40-45), Jésus qui s’est retiré dans un lieu désert, est approché par un lépreux. Touché, il le guérit, certes, mais, irrité, le renvoie aussitôt : si tous les lépreux de Palestine venaient à lui ? Et si la rumeur d’un acte comparable à une résurrection à cette époque se répandait et déclenchait un mouvement impossible à maîtriser ? Pourtant, Jésus se laissera prendre et reprendre encore aux entrailles.
La voie royale vers la compassion
Pour conclure, Lytta Basset cite le psaume 131 : « mes désirs se sont calmés comme un enfant sur sa mère ». L’auto-compassion est la voie royale vers la compassion, l’accueil de ce qui est le plus vulnérable en nous. C’est dans le terreau de l’impuissance assumée que germe et grandit le pouvoir d’accueillir la compassion, en étant bien conscient que l’on n’est pas le sauveur d’autrui
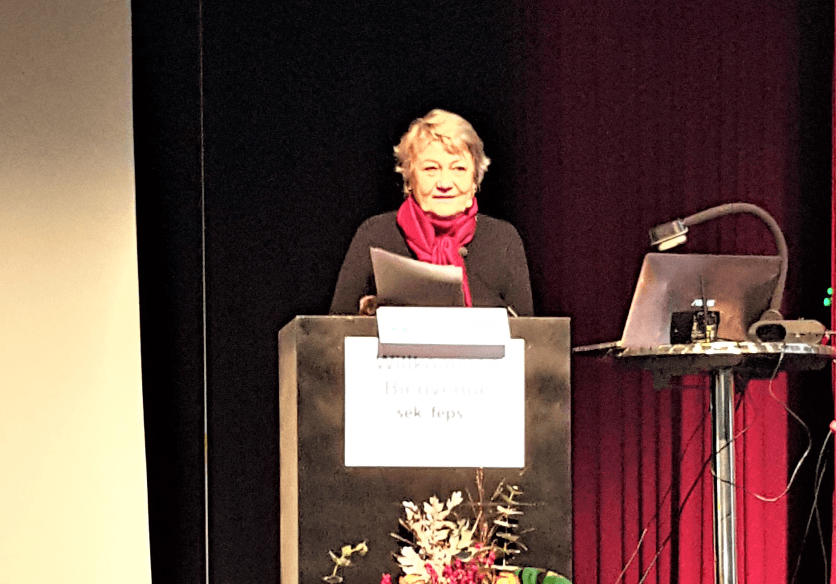
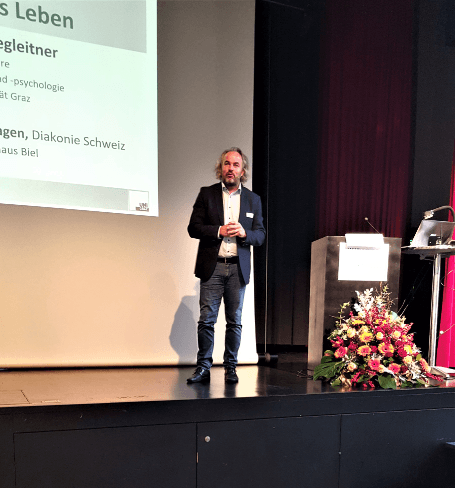
Le soin se traduit dans un réseau de relations et la question qui se pose aujourd’hui est celle de le rendre plus solide. L’accent porte moins sur les individus que sur les « ingrédients » nécessaires. Cela dépasse de loin l’amélioration de la mise en réseau, la coordination des acteurs ou l’élargissement des offres. Klaus Wegleitner y voit un processus commun de création où l’écoute joue un rôle important, la création d’une culture et d’un savoir partagés. Il faut des lieux où les gens vivent et rencontrent la vie des autres, où les expériences peuvent être partagées.
Aujourd’hui, de manière un peu carrée, on peut différencier le travail rémunéré (qui a donc une valeur économique et qui permet à celle et à celui qui l’exercent de bénéficier d’un salaire et de prestations sociales) et le soin, non rémunéré (donc sans valeur économiquement chiffrée et qui n’apporte aucune sécurité sociale à celles – le plus souvent –qui l’exercent, même si tout le monde sait que notre société ne peut pas s’en passer). La réflexion a donc aussi une dimension éminemment politique : qui œuvre dans le domaine du soin ? Qui a quelque chose à dire ? La responsabilité est-elle répartie équitablement ? Comment faire évoluer les conditions-cadres ? Une communauté pourrait donc se demander comment aménager/organiser/concevoir la vie de la communauté pour que :
Le point de vue sociologique
Les travaux de recherche du professeur Klaus Wegleitner, sociologue enseignant à Graz (A), portent sur le « care » (traduit ici par soin) qu’il définit en citant le juriste et théologien protestant allemand Thomas Klie : « eine vorausschauende, anteilnehmende Verantwortungsübernahme für sich und andere ». Le soin implique donc d’anticiper, de prendre part au souci, à la souffrance d’autrui et de prendre une responsabilité pour soi (il rejoint ici Lytta Basset) et pour l’autre.
- le partage d’expériences puisse avoir lieu,
- chacune, chacun puisse se percevoir et évoluer comme voisine, voisin,
- nous fassions preuve de plus de courage, à l’exemple du bon Samaritain.
Là aussi, pour le sociologue, la solitude est une thématique centrale. Une communauté bienveillante ouvre un espace où chacune, chacun peut advenir à soi-même, où la question de la « vie bonne » peut être appréhendée.
« La réflexion a donc aussi une dimension éminemment politique (Klaus Wegleitner)
Au tour du philosophe
La dernière conférence de la journée est donnée par Patrick Schuchter, enseignant à Graz lui aussi. Il est infirmier, philosophe et spécialiste des questions de santé publique. Sa manière très originale d’illustrer son propos a beaucoup touché l’auditoire, ce qui s’est exprimé dans le soupir de surprise et d’émotion clairement audible qui a traversé la salle à un moment donné. Patrick Schuchter évoque « Herrn Riegler », un très vieux monsieur interviewé dans le cadre de ses travaux, en lien avec trois femmes qui joueront un rôle crucial : une jeune voisine, son épouse mourante et l’infirmière à l’hospice. Trois brefs épisodes impliquant M. Riegler permettent à l’orateur de nous faire visualiser la puissance du don.
L’autre en point de mire, ou l’attention à autrui comme vertu politique
Pour M. Riegler, les journées sont grises, ses forces l’abandonnent peu à peu et son image de soi est entamée par toutes les pertes qu’il a subies. Radio, livres et CD ne sont que des substituts et ne soulagent pas sa solitude. Le conférencier souligne ici l’importance du voisinage : c’est, par exemple, cette jeune femme du voisinage, avec laquelle il n’entretient aucun lien de parenté et pas de relation de service (CMS ou autre) et à qui il prête des CD. Cette jeune mère lui dit à quel point elle est heureuse qu’il soit là, dans le quartier. Le CD que M. Riegler lui offre en une occasion est créateur de lien social. L’objet – ce CD représente ici beaucoup plus que 45 minutes de musique – est le moyen de la relation et constitue la mémoire de la personne. Il lui offre dignité et souveraineté et lui ouvre l’expérience de la gratitude. Les petites attentions créent la confiance. L’attention la plus simple et la plus fondamentale étant de se saluer entre voisins, avec le sourire. L’orateur précédent soulignait lui aussi l’impact insoupçonné des petites attentions du quotidien.
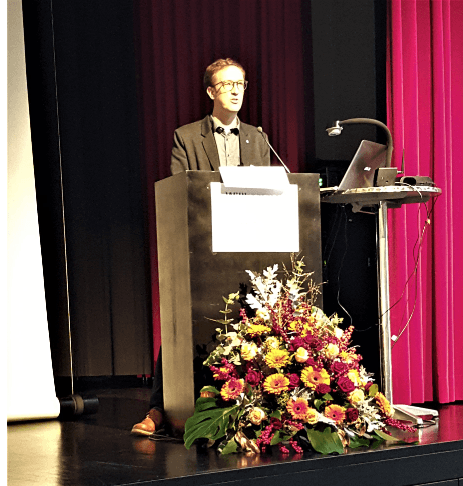
Sur son lit de mort, l’épouse de M. Riegler lui promet qu’elle sera là et l’attendra à bras ouverts lorsque son heure à lui viendra. L’infirmière, qui sait à quel point cette promesse est importante pour le vieil homme, lui dit qu’elle espère que M. Riegler sera présent pour lui tendre les bras quand son tour à elle viendra (une prouesse compassionnelle de la part de cette infirmière, selon l’orateur). À quoi le vieil homme réplique : « On verra ! »
Deux enseignements
D’abord, au plan instrumental, il y a l’État dont le rôle est de garantir les soins de base. Ce n’est pas du ressort des communautés bienveillantes qui ne sauraient se substituer à l’État ; de l’autre côté, sur un plan symbolique, ces communautés de voisinage créent la confiance, le lien social, les conditions de respect de la dignité de chacun et permette à la vie de se révéler dans toutes ses dimensions, même les plus profondes ; toutes choses que l’État (ou le marché) aurait bien du mal à assurer.
Ensuite : il y a la question de la visibilité (du manque de visibilité) du bénéfice social que génèrent les communautés bienveillantes – espace entre marché et familles – et de la reconnaissance envers leurs actrices (et parfois acteurs), qui n’est pas réglée.
Une démarche participative en groupe
Lors de cette journée, chaque personne participe, dans un groupe de sept à huit, à un échange autour des âges de la vie. Ce choix thématique s’est révélé particulièrement fructueux, chacune, chacun pouvant s’impliquer dans une double perspective, existentielle et professionnelle. Au fil de la journée, les ponts entre les apports thématiques des experts et les constats des groupes d’échange sont clairement apparus. Dans le groupe auquel j’ai participé, nous avons identifié quelques moments-clé pour chacun de ces âges et nous nous sommes demandé s’il y avait un fil rouge qui se déroulerait dans toute la vie. En quelques mots :
- 20-40 ans: période de prise d’indépendance, de déménagements fréquents (avec ce que cela peut impliquer de ruptures), d’expérimentations diverses dont celles de formes de vie diverses (quitter ses parents, colocation, ménage seul, début de la vie de couple), de disruption massive à l’arrivée d’un enfant (et, en corollaire, la solitude qui frappe certaines jeunes mères) ; cela peut aussi être une période de crise et de deuil, alors que les années passant, la jeunesse gagne une aura de bonheur, épargnée qu’elle est (serait) par les soucis et responsabilités ultérieurs.
- 40-60 ans: la période de l’expérience acquise, des années où beaucoup sont très absorbés par leur carrière professionnelle (et par la crainte de la concurrence par les plus jeunes) et d’autres pris en étau entre des enfants (et des petits-enfants) et des parents âgés. C’est aussi pour certains, à l’approche de la soixantaine, un temps de décroissance, promesse d’une liberté retrouvée (plus besoin de faire ses preuves, de se conformer aux attentes, de céder aux sirènes de la société de consommation) … mais aussi des circonstances qui obligent à se réinventer (se réorienter) ; les questions de sens émergent souvent dans ces années-là ;
- 60-80 ans: c’est le temps où plus personne n’a été épargné par les deuils, un temps qui offre pour les privilégiés en bonne santé et disposant d’une certaine aisance financière des possibilités inouïes dans une liberté retrouvée. C’est aussi le temps de la précarité pour de nombreux aînés, de la maladie, de l’entourage de plus en plus clairsemé, de la solitude. Pour les jeunes retraités, c’est souvent le temps du bénévolat dont profite grandement la vie paroissiale.
Selon les âges de la vie, la compassion s’expérimente différemment, on est donneur, preneur, les besoins changent. La solitude et le deuil (la perte) constituent le fil rouge de toute existence humaine, et le besoin d’avoir des lieux, au sens propre et figuré, de retrouvailles et d’échange et des rites de passage, des lieux où l’intergénérationnel peut advenir. Avec les années, une autre évidence s’impose : la vie humaine n’est jamais prévisible !
Pour ce groupe de partage, l’Église et ses institutions diaconales, se doivent d’être radicalement crédibles si elles entendent prendre une place de confiance dans ce vaste réseau que constitue une communauté bienveillante. L’Église ne peut pas/plus prétendre se suffire à elle-même, elle doit se mettre à l’écoute des partenaires et des bénéficiaires, ce qui implique une transformation en profondeur, d’une « Église-providence » au « faire Église ensemble ». La transformation a par ailleurs déjà commencé dans certains endroits.
Le mot de la fin …
… revient à Beat Maurer, membre du Conseil de l’Église du canton d’Argovie en charge de la diaconie et président, depuis 2017, de la conférence « Diaconie Suisse ». Après une journée riche, enracinée dans la vie, il ne repart pas avec un concept diaconal à mettre en œuvre, « la communauté bienveillante n’est pas un concept ou un programme, c’est une attitude asée sur la confiance mutuelle que l’on doit et peut vivre en Église, quelle que soient les spécificités locales ».
Compte-rendu : Anne Durrer

